un décryptage de l'oeuvre majeure du secret Fulcanelli sur Notre-Dame et la symbolique des cathédrales par le cercle Rose-Croix
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
un décryptage de l'oeuvre majeure du secret Fulcanelli sur Notre-Dame et la symbolique des cathédrales par le cercle Rose-Croix
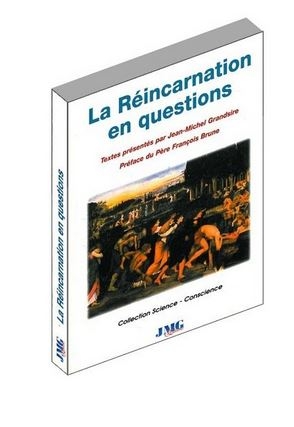
Les uns y croient et trouvent dans cette doctrine le reflet d’une justice universelle.
D’autres la rejettent, considérant qu’il s’agit d’un matérialisme déguisé, d’une inflation de l’ego faisant peu de cas de la véritable spiritualité.
Feutrée ou passionnée, la polémique fait rage entre les pour et les contre.
Dans cet ouvrage, des spécialistes font le point, présentant arguments et contre arguments, dans le seul souci de fournir aux lecteurs un dossier solidement étayé.
Qu’est-ce qui survit à la mort et se réincarne ?
Que devient l’ego ?
Qu’est-ce que la métempsycose, la transmigration des âmes ?
Quelles sont les méthodes qui conduisent à explorer les vies antérieures ?
Sont-elles fiables ?
Ce livre pose des problèmes et apporte des réponses qui aideront le lecteur à mieux se connaître, à prendre son destin en main dans la perspective d’une évolution spirituelle épanouissante.
Les auteurs :
Cet ouvrage est publié sous la direction de Jean-Michel Grandsire.
Il a été réalisé avec le concours de chercheurs, spécialistes de la réincarnation : François Brune, Laurent Guyénot, Pascale Lafargue, Pascal Vivant, Fernand Gouron, Jean Prieur, Ian Wilson, Patrice Desserre….
Préface de François Brune
La Réincarnation en questions" (Ouvrage collectif), JMG Editions
Après La Confession de Castel Gandolfo (Plon, 2008), Pietro de Pauli, pseudonyme d’un mystérieux auteur qui se cache pour s’assurer une complète liberté de parole et d’écriture, signe ce « récit » pour le moins décapant. Son héros-narrateur, Marc Belhomme, qu’on avait connu dans 38 ans, célibataire et curé de campagne (Plon, 2006), est devenu évêque d’un petit diocèse rural. Il a 53 ans quand commence ce « journal » d’un évêque de campagne, qu’il va poursuivre pendant quatre mois.
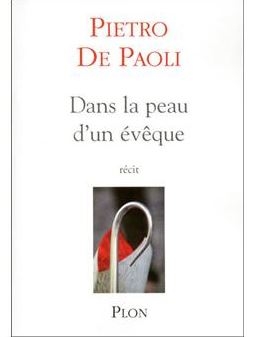
Évêque, Marc est passé de l’autre côté de la hiérarchie ; il accepte timidement de succéder aux apôtres, il endosse la responsabilité ecclésiale. Courageux, intelligent, homme de foi et de prière, il raconte. Son témoignage est déclenché par une probable tumeur au cerveau qu’on a du mal à diagnostiquer, et qui pousse à l’urgence.
Manque de vocations, vieillissement des prêtres, montée de la tradition, incompréhension du Vatican (l’Église souffrirait-elle elle-même d’une tumeur au cerveau ?), peur des évêques rassemblés à Lourdes… Le diagnostic est effrayant : on ne sait pas ce qui est pire d’une tumeur au cerveau de l’homme qui parle ou de l’Église qui se tait.
« Parfois, je me demande si l’Église n’est pas malade de la maladie de ses prêtres, de ses évêques, de son pape : la solitude […] La solitude devient un soliloque stérile qui éteint la capacité de dialogue, qui rend insupportable la contradiction […] Oui, l’Église est malade de son long soliloque, de sa solitude choisie, de son superbe isolement. » Et plus loin, il s’interroge : « Comment une religion de la communion engendre-t-elle tant de solitude ? »
Le malaise concerne tout le monde. Marc, Mgr Belhomme, est pris dans les secousses provoquées par la levée d’excommunication des quatre évêques intégristes, par l’affaire Williamson, par le viol et l’avortement de la fillette de Recife, par le buzz autour de la déclaration pontificale sur le préservatif… Il doit s’expliquer devant les curés, les paroissiens, les dames-cathé : « Une petite dame, toute menue, avec un filet de voix très doux, dit : "Sur les chambres à gaz, on peut s’expliquer, dire que c’est Williamson, mais le plus difficile, c’est quand les gens demandent pourquoi les divorcés, eux, sont toujours excommuniés." Là, c’est le déferlement, elles parlent toutes en même temps. » La question des divorcés-remariés revient fréquemment dans le récit. Mgr Marc Belhomme y est confronté : « Je crois que nous, les responsables de l’Église catholique, sommes dans l’impasse. » Et il reprend la formule du père Yves Congar : « On peut condamner une solution mais pas un problème. » Une justification jamais ne saurait faire jugement. Or, il s’agit bien de cela. Belhomme constate que l’Église se ferme sur elle-même à tous les niveaux.
DANS LA PEAU D’UN ÉVÊQUE, Pietro de Pauli
Éditions Plon, 291 p., 19,90 €

Une belle analyse de l'histoire de la franc maçonnerie, surtout dans ses rapports aux symbolismes et ses relations avec l'église catholique. Plein de citations, de références, etc...Complémentaire d'un livre comme Séthos de l'abbé jean Terrasson qui informe le lecteur des rites maçoniques puisés dans l'Egypte ancienne
Je le conseille à tout le monde.
Comprendre les franc-maçons, de Jean Saunier, Editions Ivoire Clair

Du lien mystique-politique au devenir de notre vingt-et-unième siècle, en passant par leur définition de la Liberté, la place de Dieu, les intégrismes ou la technologie…, l’homme de foi et le politique nous dévoilent, de manière très directe, leur propre perception des choses : la place de la politique dans tout ça et la présence de Dieu dans notre condition humaine. Rapidement pour les deux hommes, l’Homme et l’humanité prennent le pas dans leur discours et leur proposition pour société meilleure et plus juste pour chacun de nous.
Du lien mystique-politique au devenir de notre siècle, en passant par leur définition de la Liberté, la place de Dieu et les intégrismes… André Gence et Jean-Jacques Léonetti nous dévoilent dans cet ouvrage leur perception des choses avec pour seul souci : l’Autre.
Mystique et Politique - Alain Melka - Gence - Léonetti, Collection Récits et Témoignages 2006
Suite de la chronique sur le livre , L’abbé Mugnier, le confesseur du Tout-Paris
« Je ne confesse pas, j’absous ! » La théologie morale de l’abbé se porte jusqu’à l’extrême du 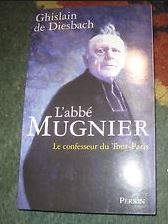
Mais peut-on s’intéresser encore à l’abbé Mugnier ? Le contexte, ecclésial, littéraire, mondain, dans lequel il a vécu a disparu et nous semble aussi lointain que les salons du Grand Siècle. L’Église, en dépit de quelques efforts louables, est toujours à des années-lumière des mouvements artistiques et littéraires. Les chanoines faiseurs de bons mots (Mugnier était chanoine !) ne subsistent que par exception, et l’abbé, selon le mot de la fin cité par son biographe, reste plus admirable qu’imitable, mirandum, non imitandum. Reste un homme aux prises avec les grandeurs et les petitesses de son temps, dont la capacité d’enthousiasme devrait nous réconforter sur le nôtre.
Ghislain de DIESBACH, L’abbé Mugnier, le confesseur du Tout-Paris, Perrin, 340 p., 21,50 €